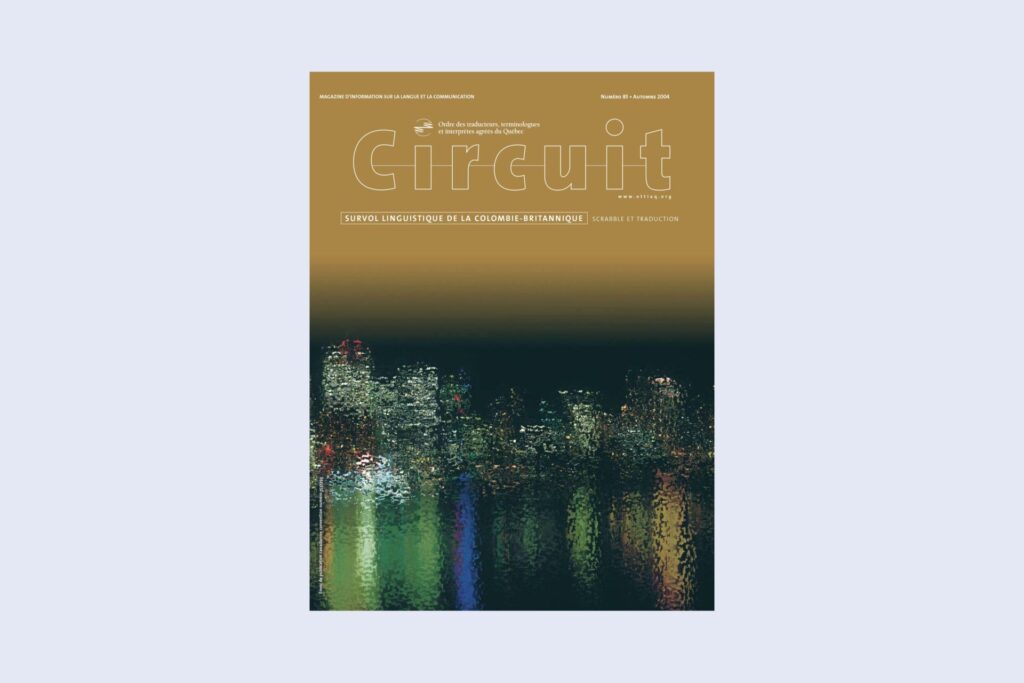Mettre la science en français sur la carte : le rôle stratégique d’Érudit
Alors que l’anglais s’impose comme langue de la science, Érudit démontre qu’un autre modèle est possible : ouvert, francophone, rigoureux et profondément collaboratif.

Par Gwendal Henry
Une infrastructure numérique au service de la science francophone
Lancée en 1998 par les Presses de l’Université de Montréal, Érudit est l’une des premières plateformes numériques francophones consacrées à la diffusion savante. À une époque où Google n’existait pas encore, son objectif était de rendre accessibles en ligne les publications scientifiques québécoises, en particulier en sciences humaines et sociales (SHS). Le projet prend de l’ampleur en 2004, avec la création du Consortium Érudit par l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’UQAM, assurant une gouvernance partagée et une pérennité institutionnelle. Puis, en 2018, Érudit s’associe au Public Knowledge Project1 pour fonder Coalition Publica, une infrastructure ouverte, publique et non commerciale, consacrée à la publication numérique savante au Canada. Aujourd’hui, ce sont plus de 350 revues scientifiques et culturelles qui sont diffusées sur la plateforme erudit.org, dont une large majorité est en libre accès. Totalisant plus de 240 000 articles, cette collection est massivement consultée : 38 millions de pages vues chaque année par cinq millions d’utilisateur·trice·s, dont 75 % proviennent de l’extérieur du Canada.
Les publications diffusées sur cette plateforme ne sont pas consultées que dans les milieux universitaires. La plateforme est également fréquentée par de nombreux enseignant·e·s, professionnel·le·s et internautes curieux, à la recherche de contenus rigoureux sur des enjeux d’actualité. Par exemple, l’un des articles les plus lus en 2024 traite de l’anxiété d’évaluation chez les adolescent·e·s. Il a été rédigé par un groupe de chercheur·euse·s québécois·es en psychoéducation à partir d’une vaste enquête menée auprès de 10 000 jeunes du Québec.
Un recul préoccupant du français dans la publication scientifique
Malgré ce dynamisme apparent, les publications savantes en français font face à une érosion notable. Dans les années 1990, environ 20 % des nouvelles revues scientifiques créées au Canada étaient en français. Aujourd’hui, cette proportion est tombée sous la barre des 5 %. À cela s’ajoute une baisse importante du nombre de manuscrits soumis aux revues francophones canadiennes, alors même que le français représente la cinquième langue la plus parlée au monde et la troisième en importance sur Internet. Ce recul s’explique en grande partie par la domination structurelle de l’anglais dans les mécanismes de valorisation scientifique : indexation dans les bases de données, facteurs d’impact, classements des revues, évaluation de la performance des chercheur·euse·s. Les langues autres que l’anglais sont systématiquement désavantagées dans les grands systèmes de classement, ce qui pousse de nombreux chercheur·euse·s à publier dans une langue seconde pour répondre aux critères d’excellence scientifique dominants.
Or, les conséquences de cette dynamique sont profondes. Dans les domaines des sciences humaines et sociales, publier dans la langue des communautés concernées favorise une meilleure appropriation sociale des résultats de recherche. De plus, l’usage du français en science contribue à la littératie scientifique, un levier essentiel pour contrer la désinformation, et participe à la bibliodiversité, c’est-à-dire à la diversité linguistique, disciplinaire et méthodologique des publications savantes.
Langues, découvrabilité et traduction
Si publier en français facilite l’accès aux savoirs pour les communautés francophones, cela ne garantit pas leur visibilité. Dans un environnement numérique saturé de contenus anglophones, la découvrabilité des publications est devenue un enjeu stratégique. Un article rigoureux, mais mal balisé, mal traduit ou mal indexé, risque fort de demeurer invisible. C’est ici que les professionnel·le·s de la langue apportent une valeur ajoutée déterminante. Ils et elles peuvent contribuer activement à rendre les publications plus découvrables, en soutenant les pratiques suivantes :
- la traduction des résumés et mots-clés dans une ou plusieurs langues;
- l’usage de termes normalisés, issus de banques terminologiques fiables;
- la production de métadonnées multilingues;
- la révision linguistique, qui assure un équilibre entre précision scientifique et clarté rédactionnelle.
Sur la plateforme erudit.org, ces éléments permettent aux articles d’être repérés par des moteurs de recherche (comme Google ou Google Scholar), indexés dans des agrégateurs internationaux, ou accessibles via des catalogues de bibliothèques dans le monde entier. Sans ces efforts, même les recherches les plus innovantes risquent de sombrer dans l’invisibilité.
Un avenir à construire collectivement
Penser et publier en français représente une condition de base pour maintenir un patrimoine intellectuel vivant et enraciné dans les réalités sociolinguistiques des communautés de recherche. Il s’agit également d’un vecteur de démocratisation des savoirs, dans une société où les frontières entre monde académique, société civile et milieux professionnels s’estompent. La grande majorité des chercheur·euse·s canadien·ne·s, notamment celles et ceux des sciences humaines et sociales, en sont bien conscient·e·s : des données probantes ont démontré que lorsqu’un article présente des résultats de recherche s’inscrivant dans le contexte canadien, le français est nettement privilégié.
Le maintien et la promotion de la science en français ne peuvent cependant reposer uniquement sur les épaules des chercheur·euse·s. Il s’agit d’un chantier collectif : des revues qui persistent à publier en français, des traducteur·trice·s et des terminologues qui assurent le lien entre les langues, des plateformes comme Érudit qui soutiennent la diffusion libre et équitable du savoir, et des lecteur·rice·s qui continuent de s’informer et de transmettre.
C’est dans cette chaîne, technique et humaine, que se joue l’avenir d’une science plurielle, inclusive, durable… et en français!
Gwendal Henry est directeur des communications et de l’engagement à Érudit, gwendal.henry@erudit.org
1 Plateforme née d’un partenariat entre différentes universités canadiennes et étatsuniennes, qui héberge des publications indépendantes et des revues scientifiques en libre accès.