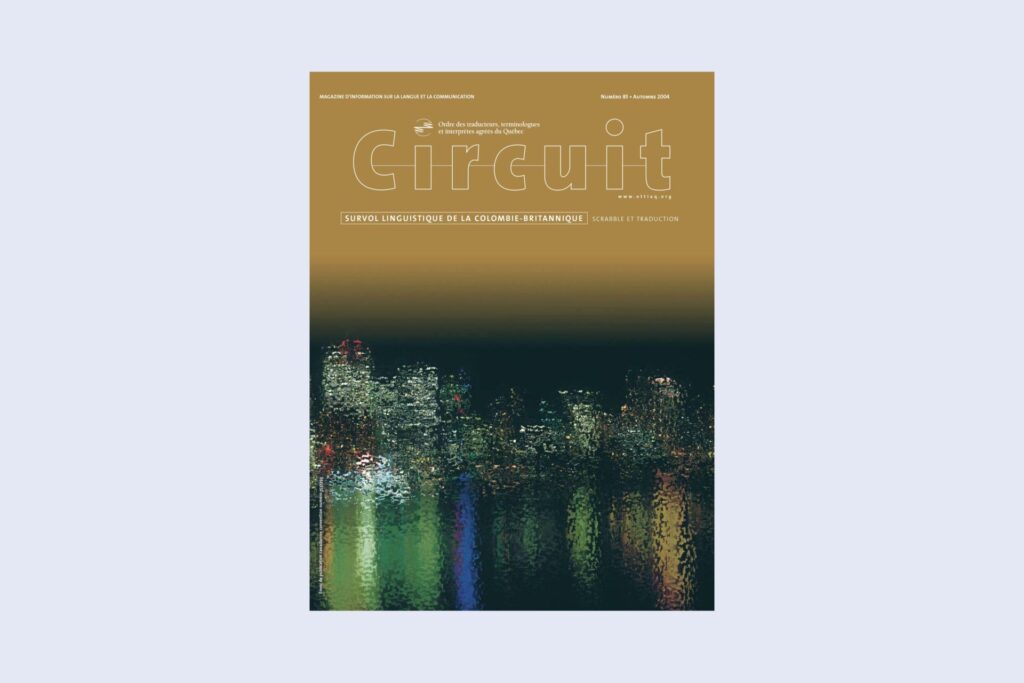Le français au service du savoir
Le Réseau des traducteurs et traductrices en éducation (RTE) a récemment fêté ses 40 ans d’activité. La fondatrice de l’organisme rend ici hommage à ce réseau unique qui, dit-elle, a enrichi sa vie professionnelle et personnelle au plus haut degré, et qui est aussi un exemple parfait de réseautage au service de notre profession et du savoir.

Par Liliane Vincent
Il faut remonter à l’adoption par le Parlement canadien de la Loi sur les langues officielles en 1969 pour comprendre la genèse du RTE. Dans la foulée de cet événement déterminant pour notre société, un programme de subventions incitait les organismes sans but lucratif à publier leurs documents en français et en anglais. Des services de traduction ont alors vu le jour dans les conseils et commissions scolaires, dans les associations professionnelles de l’enseignement, ainsi que dans les collèges et les universités partout au pays. C’était l’ère pionnière de la bilinguisation.
Les personnes récemment diplômées des écoles universitaires de traduction qui travaillaient dans ces services affrontaient toutefois de nombreux défis : l’isolement, le manque de ressources et des attentes de production irréalistes en raison de la méconnaissance de la profession. S’ajoutaient la tâche herculéenne d’épurer le vocabulaire de l’éducation alors truffé d’anglicismes, d’usages fautifs et d’emprunts, ainsi que celle de promouvoir l’uniformisation.
Ces services de traduction ne disposaient pas de banque de terminologie ni de mémoire informatique. Les outils de travail consistaient tout simplement en une machine à dicter ou à écrire, quelques dictionnaires et encyclopédies, et des centaines de fiches sur lesquelles étaient consignées les trouvailles terminologiques. Le télécopieur, la merveille du jour, servait à transmettre les « urgences ».
La naissance du RTE
L’éducation, une science en soi, est en quelque sorte la mère de toutes les sciences, car elle est le vecteur des connaissances pluridisciplinaires, du développement d’idées et de la pensée critique, tout en étant le reflet de l’environnement socioculturel. Le travail langagier dans un milieu aussi englobant exigeait des efforts concertés.
C’est du sentiment partagé d’isolement et de frustration devant le manque de documentation fiable, ainsi que de l’immense souci de fournir des services de qualité, qu’est née l’idée d’un réseau. C’est ainsi que quatorze personnes travaillant dans divers milieux — éducation élémentaire, secondaire et postsecondaire, ministères de l’Éducation et associations professionnelles — se sont réunies en 1985. En l’espace de quelques heures, elles ont convenu de trois objectifs : mener des travaux terminologiques, partager leurs ressources documentaires et tenir des réunions bimestrielles axées sur le développement professionnel continu. Les initiatives se sont multipliées à un bon rythme et le bouche-à-oreille a fait grossir les rangs du RTE, qui a réussi à atteindre plus d’une centaine de membres de différents coins du pays.
Voici quelques moments marquants de l’évolution du RTE :
- Dès la première année, des liens de collaboration sont établis avec l’équipe de terminologie du Secrétariat d’État du Canada. Peu après, un protocole de rédaction des fiches prend forme.
- Le RTE obtient un siège au Comité de terminologie du ministère ontarien de l’Éducation.
- À tour de rôle, les employeurs invitent le RTE à tenir ses séances de travail chez eux. Ainsi, les membres de l’organisme d’accueil gagnent en visibilité et en reconnaissance dans leur propre milieu et contribuent au rayonnement du travail du RTE : une stratégie qui porte ses fruits.
- En 1988, le RTE commence à vendre ses Recommandations terminologiques par abonnement, entreprise qui connaît un franc succès. Des néologismes créés par le RTE sont mis en évidence, tels que cours à double emploi (anti-requisite), poste à financement flottant (soft-funded position) et enseignant(e)-guide (lighthouse teacher).
- À compter de 1990, afin d’encourager la relève, le RTE décerne tous les ans une bourse d’excellence à une personne inscrite à un programme de traduction universitaire.
- La même année, un premier colloque de deux jours s’organise pour répondre aux besoins de perfectionnement professionnel. Le thème de l’événement, Exploration des services de traduction : au-delà de leur rôle traditionnel, reflète le souhait de sortir de la conception étriquée de la profession. Les ateliers et conférences portent sur la gestion d’un service de traduction, la nomenclature d’un organisme, la publication de billets linguistiques et l’aide à la rédaction, entre autres. Une dizaine de colloques de deux jours suivront au fil des années.
- En 1994 paraît le premier numéro du bulletin linguistique trimestriel En bons termes – On Good Terms, un nouveau fleuron à la couronne du RTE.
- L’ère technologique s’installe progressivement et transforme les méthodes de travail. En même temps, les budgets de déplacement s’appauvrissent. Les effectifs dans les bureaux s’amenuisent. Le nombre de membres indépendants augmente. Il n’est plus possible de maintenir la fréquence des réunions ni la publication des fiches et du bulletin. Un essoufflement impose une rationalisation des activités. Il convient de rappeler que l’œuvre du RTE tient entièrement au bénévolat.
- La voie électronique devient la solution incontournable pour rejoindre un plus grand public et simplifier la diffusion. Le Groupe coordonnateur veille à l’automatisation des communications du RTE. Ensuite, la liste de diffusion devient une réalité, permettant de surmonter l’isolement géographique et professionnel.
Dans ce tourbillon, au cours de ses 40 ans d’existence, le RTE a su maintenir ses valeurs fondamentales : l’entraide et le professionnalisme, sous le signe de la collégialité et de l’adaptabilité. Il a su embrasser les nouveautés technologiques pour construire et alimenter un site Web unique avec un logo et un style au goût du jour. Aujourd’hui, les réunions se tiennent surtout par vidéoconférence. Des partenariats avec d’autres organismes se poursuivent et le RTE est présent sur les médias sociaux. Les causeries mensuelles du midi permettent des remue-méninges sur des difficultés de traduction. L’entraide quotidienne est possible grâce à la liste de diffusion, précieux outil d’échange d’idées, de conseils et d’informations.
Solidarité dans la sauvegarde du français
Le français joue un rôle fondamental dans les sciences humaines, notamment en éducation. Offrir l’enseignement et la recherche en français contribue en effet à la lutte contre l’uniformisation des savoirs. Dans un monde largement dominé par l’anglais, préserver des espaces scientifiques francophones est donc un acte à la fois pédagogique et éthique.
Dans cet esprit, la fondation du RTE a été une libération de l’isolement à l’époque où la traduction au Canada était une profession méconnue, sous-estimée et, dans certains cas, vue d’un mauvais œil en raison des dépenses s’y rattachant. On trouve encore aujourd’hui des échos de cette situation : par exemple, les processus traductionnel, terminologique et rédactionnel demeurent essentiellement les mêmes; les textes de départ sont souvent ambigus ou complexes; les néologismes se multiplient; et les slogans donnent du fil à retordre. Autres réalités qui survivent au temps : l’isolement n’est pas toujours facile à vivre et le perfectionnement ne s’effectue pas en vase clos.
Au fil des années, en se regroupant au sein du RTE pour faire face à ces réalités, les traductrices et traducteurs en éducation ont choisi d’acquérir des compétences complémentaires : la rédaction d’articles linguistiques, l’organisation de colloques, la présidence de séances de travail, l’animation d’ateliers et la participation à des groupes de travail. La conception de la profession s’est ainsi élargie pour inclure la recherche, la formation, la planification, la gestion de projets, la rédaction et les conseils linguistiques au sein des établissements d’enseignement.
Par leurs diverses activités professionnelles, les membres du RTE continuent de jouer un rôle de premier plan dans le maintien de la qualité de la langue française dans le domaine de l’enseignement. Leurs traductions et leurs recherches terminologiques permettent aujourd’hui et permettront demain de former les futurs chercheurs et scientifiques, assurant la vitalité et l’avancement des secteurs touchés. En résumé, il ne s’agit pas simplement de traduire des termes et des textes, mais des notions et des réalités scientifiques, technologiques et socioculturelles, le savoir et le savoir-faire qui font notre spécificité et notre dynamisme.
Liliane Vincent a passé la majeure partie de sa vie professionnelle à la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, où elle a notamment mis sur pied les Services linguistiques. Elle a fondé le Réseau des traducteurs et traductrices en éducation, qu’elle a présidé pendant une décennie. L’excellence de son travail a été reconnue par l’Internationale de l’Éducation ainsi que par l’Association des traducteurs et interprètes de l’Ontario (ATIO) et le Conseil supérieur de la langue française.