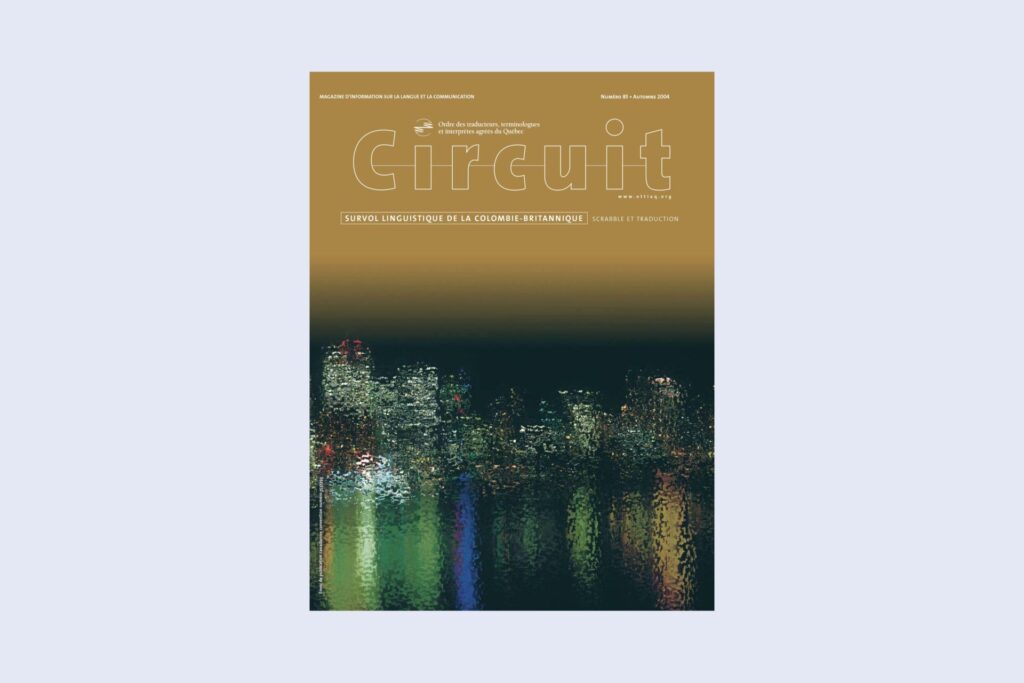Défense et illustration de la recherche en français
En 2021 déjà, l’Acfas tirait la sonnette d’alarme sur la marginalisation de la recherche en français1. Quatre ans plus tard, où en est la réflexion sur le rôle que les traducteurs et terminologues peuvent jouer dans la diffusion d’une science en français?

Par AnneMarie Taravella, traductrice agréée (OTTIAQ)
En 1549, le poète Joachim Du Bellay avait choisi de structurer son ouvrage Défense et illustration de la langue française2 en deux parties : l’importance de la langue (sa « défense ») et les moyens de l’enrichir (son « illustration »). Cet article lui emprunte la structure du propos.
Défendre la science en français, une question d’efficacité
Dans une lettre ouverte publiée le 22 avril 2025, Sophie Montreuil et Martin Maltais, respectivement directrice générale et président de l’Acfas, déploraient que le faible montant accordé pour favoriser la recherche en français fît passer le message suivant : « (L)es sciences en français, ce n’est pas une priorité scientifique. C’est une affaire de culture3. »
Or, on peut faire valoir au contraire que les sciences en français sont une priorité scientifique. Pour être minoritaire au Canada, la communauté scientifique francophone n’en est pas moins vivante, productive et exemplaire à l’échelle mondiale, comme l’illustre le fait que le 92e Congrès de l’Acfas, le plus grand événement scientifique interdisciplinaire de la francophonie, qui s’est tenu du 5 au 9 mai à l’École de technologie supérieure à Montréal, a hébergé plus de 245 colloques scientifiques4 en français. D’ailleurs, l’Organisation internationale de la francophonie, qui a pour mission notamment d’appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche et de promouvoir la langue française, représente 93 États et gouvernements membres. La recherche en français mérite donc sa propre expression linguistique.
Défendre notre culture, c’est déjà ça. Nous exprimer dans notre langue dominante, celle dans laquelle nous pensons, nous rêvons, c’est précieux, nécessaire, structurant. Pourtant, une science en français, c’est bien plus qu’une concession à l’existence de la culture francophone. C’est la possibilité pour les francophones de s’adresser dans leur langue dominante à la communauté scientifique et de lire dans cette même langue ce qu’écrivent leurs pairs. De plus, s’exprimer et s’informer dans sa langue dominante est un gage d’efficacité pour la communauté scientifique. Bien sûr, rédiger ou lire un article en anglais, pour une personne francophone, c’est possible, mais est-ce efficace? Dans un rapport publié en juin 20245, le Fonds de recherche du Québec souligne que « la mobilisation des connaissances en français peut aussi être motivée par la recherche d’une plus grande productivité », car « les francophones doivent davantage travailler et consacrer plus de temps à la préparation d’un article s’ils veulent le soumettre en anglais6 », par exemple. Et que perd le lectorat dans la compréhension qui aurait été utile, voire indispensable, à la poursuite de la réflexion? Ce même rapport indique que les chercheurs francophones qui rédigent leurs travaux en français ont « un propos plus précis et nuancé, tout comme une analyse plus complexe et riche7 » que lorsqu’ils s’astreignent à s’exprimer en anglais. Autrement dit, non seulement l’expression en français accroît l’efficacité des chercheurs francophones, mais elle leur permet d’exprimer toute la nuance de leur pensée novatrice. C’est toute la recherche qui y gagne.
Enrichir la science en français en valorisant la terminologie
En mars 2024, une journée d’étude sur le thème Pour la science en français (organisée par le Commissaire à la langue française du Québec avec la collaboration d’UdeM français) a eu lieu à l’Université de Montréal. L’intention était de réfléchir à la manière dont la traduction et la terminologie pouvaient « contribuer à redonner au français une place de choix en science et en recherche au Québec8 ». Les participantes et participants y ont évoqué notamment la création d’un pôle d’expertise québécois sur la traduction scientifique et le français en science (une des recommandations figurant dans l’avis du commissaire à la langue française, publié en
octobre 20239).
Il y a aussi été question d’un sujet particulièrement pertinent : la complexité et la diversité des terminologies scientifiques. Par « terminologie scientifique », on n’entend pas seulement les termes qui nomment de façon stable une réalité scientifique bien connue (comme « sclérose latérale amyotrophique » ou « maladie de Lou Gehrig », ou « ligne de désir10 », ou encore « œil du
prince11 »)12. On entend surtout l’usage flottant que pratiquent les auteurs pour désigner un même objet de recherche, en évolution. Voici par exemple quelques notes prises en 2017, en lien avec une recherche sur l’« engagement au travail » :
Pour Academic Search Complete et Business Source Complete (EBSCO), seul « job involvement » est un sujet du thésaurus; le lecteur intéressé par « employee engagement » est renvoyé à « job involvement »; « job engagement » et « work engagement » ne donnent aucun résultat dans la liste des sujets. Dans PSYCInfo et PSYCArticles, « employee engagement » est un sujet du thésaurus au même titre que « job involvement », tandis que pour ProQuestCentral, le seul sujet répertorié dans le vocabulaire contrôlé est « employee involvement ». Le manque d’uniformité terminologique vient ajouter à la difficulté de distinguer les concepts. (Notes personnelles de l’autrice du présent article)
Un chercheur rédigeant un article scientifique serait donc bien avisé de dresser le pedigree de tous les concepts et de leurs désignations diverses, selon tel ou tel auteur, qu’il utilise, avant d’exposer son propre point de vue, s’il veut s’inscrire dans la bonne conversation scientifique. Il faut donc non seulement des traducteurs scientifiques, mais aussi des terminologues faisant preuve d’une passion et d’une persévérance d’airain.
Pôle d’expertise, valorisation de la profession, augmentation du financement de la recherche en français et de la découvrabilité des contenus en français sont autant d’excellentes façons de promouvoir la science en français, mais aussi de mettre en valeur les connaissances approfondies en traduction – et en terminologie – que doit posséder quiconque veut rédiger ou traduire un contenu scientifique.
AnneMarie Taravella est traductrice agréée (OTTIAQ) et terminologue, diplômée de l’Université Concordia en traductologie et de l’Université Paris-Dauphine et de l’Université de Sherbrooke, en administration des affaires. Elle est également chargée de cours en traduction professionnelle.
1 St-Onge, S., E. Forgues, V. Larivière, A. Riddles et V. Volkanova (2021). Portraits et défis de la recherche en français en contexte minoritaire au Canada. [En ligne], https://www.acfas.ca/sites/default/files/documents_utiles/rapport_francophonie_final.pdf
2 Du Bellay, J. (1549). La défense et illustration de la langue française. Version numérisée [En ligne], https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k166650v.pdf
3 Montreuil, S. et M. Maltais (2024). « À quand un gouvernement qui défend la recherche en français? ». Le Journal de Québec, 22 avril 2025.
4 Site Web de l’Acfas : https://www.acfas.ca/evenements/congres
5 Fonds de recherche du Québec. (2025). Soutenir et rehausser la recherche en langue française : vers une action structurante et concertée, p. 7. https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2024/06/20240329_rapport-langue-francaise_cie-frq_versionfinale.pdf
6Amano et al., 2023, cité dans Ibid., p. 7
7 Bortolus, 2012, p. 769-770, cité dans Ibid., p. 7
8 Communication par courriel d’UdeM français, 21 février 2024.
9 Commissaire à la langue française. « Le français, langue du savoir? Pour une approche structurée de l’usage de la traduction automatique dans le milieu scientifique. » 31 octobre 2024. [En ligne], https://www.commissairelanguefrancaise.quebec/wp-content/uploads/2023/10/CLF_Brochure_Avis_LangueDuSavoir_WEB.pdf
10 En développement urbain, « chemin qu’empruntent spontanément les piétons ou les cyclistes pour se déplacer d’un point A à un point B par souci d’efficacité ou d’agrément, sans se limiter au chemin “officiel” établi par les autorités » (source : Société de développement Angus)
11 Dans un théâtre à l’italienne, « point idéal des lignes de fuite, couramment appelé “l’œil du prince”, en fonction de la place occupée dans la salle par les dignitaires » (source : Universalis)
12 Je salue ici les étudiant.e.s des cours de terminologie de l’Université de Sherbrooke et de l’Université de Montréal qui m’ont fait connaître ces deux derniers termes, entre autres, et qui se reconnaîtront.