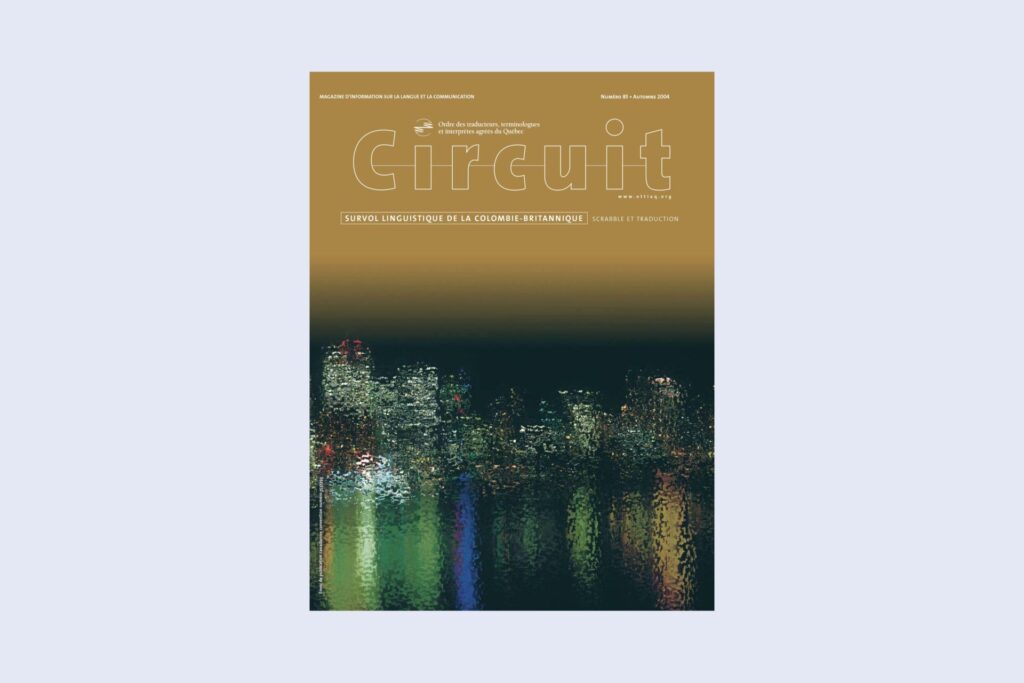Par Philippe Caignon, terminologue agréé et traducteur agréé
Dans un monde où la langue des communications savantes est l’anglais et dans un pays où la majorité des échanges scientifiques se font en anglais, on peut se poser une question : dans un tel contexte, comment se porte la langue française dans les sciences?
La question est pertinente et sa réponse est révélatrice : le français ne va pas très bien, mais la situation pourrait être pire et nous ne sommes pas impuissants. Il y a donc encore de l’espoir.
La formation d’une relève francophone en science
Dans cette perspective, l’un des aspects qui devrait nous intéresser le plus, car il nous renseigne sur la vitalité future de la langue française, c’est la formation de la relève. En effet, non seulement la relève exercera toutes les professions possibles, mais elle sera appelée à effectuer de la recherche technique et scientifique qui enrichira et facilitera l’existence de tout le monde. De fait, former la relève et lui donner les outils intellectuels, culturels et linguistiques est essentiel.
Pas si facile
Or, puisque les sciences sont dominées par l’anglais et que leur terminologie de pointe est le plus souvent créée dans cette langue, on constate un retard systémique dans l’adoption et l’utilisation des termes français dans les sciences. De fait, les apprenantes et apprenants francophones sont parfois terminologiquement mal outillés pour parler, écrire et publier en français, ce qui réduit leurs moyens d’expression et fragilise la pérennité de la recherche en français.
Notons par ailleurs que dans les conférences, congrès et colloques internationaux, les appels à communication sont surtout lancés en anglais. Bien entendu, au Canada et dans les autres pays appartenant à la Francophonie, le français est présent. Toutefois, si nous prenons le cas du Canada, hors Québec, lorsqu’une proposition de communication est acceptée, peu de personnes vont assister à la présentation de la conférencière ou du conférencier de langue française, car peu de personnes possèdent assez de savoir spécialisé en français pour comprendre l’information qui est transmise. La relève francophone fait donc face à un problème de connaissance de la part de la collectivité scientifique nationale et internationale, ce qui peut nuire à sa reconnaissance et réduire d’autant plus la perception de la légitimité de l’usage du français dans les sciences.
Cette situation est semblable pour les appels à articles, à actes de conférences et à chapitres de livre. Il y a en effet peu d’occasions de s’exprimer et de briller de mille feux intellectuels en français hors francosphère… et à l’occasion hors Québec – nous faisons ici un clin d’œil aux revues franco-françaises qui choisissent d’angliciser leur titre et de publier en anglais (la chronique de Maria Ortiz Takacs vous en dira plus long à ce sujet) pour augmenter leur tirage et leur visibilité mondiale.
Quelques pistes de solution
La langue-culture dans laquelle une personne s’inscrit, pense et communique n’est pas un simple outil de transmission informationnel neutre. Elle structure en profondeur la manière de percevoir, de catégoriser et d’analyser la « réalité ». Elle reflète une vision singulière du réel et détermine ainsi une approche scientifique unique.
En effet, pour chaque discipline scientifique, la pluralité des points de vue se révèle précieuse. Elle influe sur la manière de poser des questions, d’élaborer des hypothèses, de structurer des raisonnements et d’interpréter des résultats. Elle est instrumentale pour contrer l’homogénéisation des cadres de pensée et des méthodes de recherche freinant l’innovation et appauvrissant la pensée critique et scientifique. De fait, préserver et valoriser la diversité des langues-cultures dans la recherche ne relève pas uniquement d’une volonté de justice culturo-linguistique, mais constitue un enjeu fondamental pour la vitalité, la créativité et la pertinence de la science.
Comme langue véhiculant diverses cultures, le français participe de façon significative à l’enrichissement des sciences. Afin d’encourager son utilisation continuelle et d’augmenter sa portée, il faut donner à la relève les outils d’apprentissage et d’expression dont elle a besoin ainsi que des occasions pour rayonner efficacement.
À cette fin, comme vous pourrez le lire dans l’article d’AnneMarie Taravella, il faut financer davantage les travaux de recherches effectués en français. En outre, nous nous devons de promouvoir l’emploi de la langue française dans les laboratoires et les salles de classe en éducation supérieure. Les chercheurs et chercheuses doivent être par ailleurs encouragés à écrire et à parler de leurs travaux en français en plus d’être incités à assister aux communications et à lire les résultats des travaux scientifiques de leurs pairs. Faire la promotion médiatique et interpersonnelle des idées, hypothèses, théories et découvertes provenant des scientifiques francophones auprès des chercheuses et chercheurs anglophones ou allophones constitue également une stratégie de promotion du français efficace.
Traduction, interprétation et terminologie
De plus, comme on le verra dans l’article de Donald Barabé, la traduction, l’interprétation et la terminologie peuvent contribuer à l’innovation et à la transmission des connaissances en français dans les sciences. Ainsi, donner une appellation française à un concept conçu dans une autre langue, créer un terme français de toute pièce lorsqu’une découverte est effectuée dans une institution ou une entreprise francophone, concevoir des bases de données ou des dictionnaires ayant des entrées en français sont autant d’activités professionnelles qui participent à la diffusion du français dans les sciences, et ce, dans le monde entier.
Le français comme cas de figure
Bien sûr, même si nous nous concentrons ici sur la langue de Molière, le phénomène de repli que nous observons touche toutes les langues de la planète, sauf une. Par conséquent, le français fait cas de figure et se révèle un excellent exemple pour étudier ce que vivent les scientifiques qui travaillent de par la Terre, à l’exception de celles et de ceux qui exercent dans l’anglosphère.
Une situation complexe
En effet, la situation actuelle se développe depuis de nombreuses décennies et relève d’une conjoncture mondiale complexe mais soutenue. Ses origines sont diverses et ses racines sont profondes, car de nombreux éléments participent au phénomène. Dans le présent numéro de Circuit, nos autrices et auteurs explorent donc certains aspects de cette réalité et proposent aussi quelques solutions.
Ainsi, AnneMarie Taravella, traductrice agréée, réfléchit sur le rôle que les traductrices, traducteurs et terminologues jouent dans la diffusion de la science en français. Madame Taravella rappelle notamment la proposition du Commissaire de la langue française de créer un pôle d’expertise québécois sur la traduction scientifique et le français en science. Elle en profite pour aborder des sujets fort pertinents dont le manque de fonds accordés à la recherche de langue française. En outre, elle mentionne le Congrès annuel de l’Acfas, le plus grand évènement scientifique interdisciplinaire de la francophonie, comme exemple d’événement qui accroît la visibilité mondiale de la recherche française.
Ensuite, Gwendal Henry, directeur des communications et de l’engagement à Érudit, nous explique l’origine de la plateforme numérique francophone consacrée à la diffusion savante. Devant le recul démontré du français dans la publication scientifique, Monsieur Henry montre également à quel point la traduction est importante pour accroître la découvrabilité et le repérage du contenu scientifique francophone par les moteurs de recherches. Il rédige aussi un plaidoyer en faveur d’une stratégie unissant l’industrie langagière et la communauté scientifique pour construire un patrimoine intellectuel ancré dans le vécu sociolinguistique des communautés de recherche francophones.
Pour sa part, Donald Barabé, traducteur agréé, nous dévoile comment les langagières et langagiers participent non seulement à la diffusion de la connaissance mais aussi à la démocratisation du savoir et donc à l’évolution de l’humanité. En outre, il nous fait part de son avis sur le rapport du Commissaire de la langue française sur l’usage de la traduction automatique en science et sur la création du Pôle d’expertise sur la traduction scientifique et le français en science.
Pour terminer, Liliane Vincent, fondatrice du Réseau des traducteurs et traductrices en éducation (RTE), nous révèle une page méconnue de l’histoire traductive du pays en nous racontant la genèse de ce réseau professionnel. Nous nous devons d’ailleurs de saluer élégamment les quarante ans du RTE, quatre décennies durant lesquelles ce réseau a renforcé les diverses visions francophones canadiennes éducatives par la traduction et la terminologie et a avivé chez les apprenantes et apprenants ainsi que chez les éducatrices et éducateurs le sentiment d’appartenance au peuple franco-canadien.
En complément de ce dossier, Maria Ortiz Takacs, traductrice agréée, traite dans la chronique La esfera hispánica du dilemme culturo-linguistique auquel sont confrontés les chercheurs et chercheuses de la francophonie. Ainsi, ces érudits font face à un choix déchirant : en effet, s’ils optent pour une notoriété internationale élargie, promue par la langue anglaise, ils participent possiblement à la disparition progressive de leur identité de scientifiques francophones. Madame Ortiz Takacs nous présente aussi des exemples patents de revues françaises dont le titre a été anglicisé pour accroître leur lectorat et leur renom. La chronique est rédigée en espagnol, comme toujours, mais son sujet est profondément francophone et francophile.
L’équipe de Circuit espère que ce numéro saura vous plaire et susciter une réflexion stimulante sur la place du français dans la science et sur l’apport de l’industrie de la langue dans la promotion et la survie du français dans les sciences.