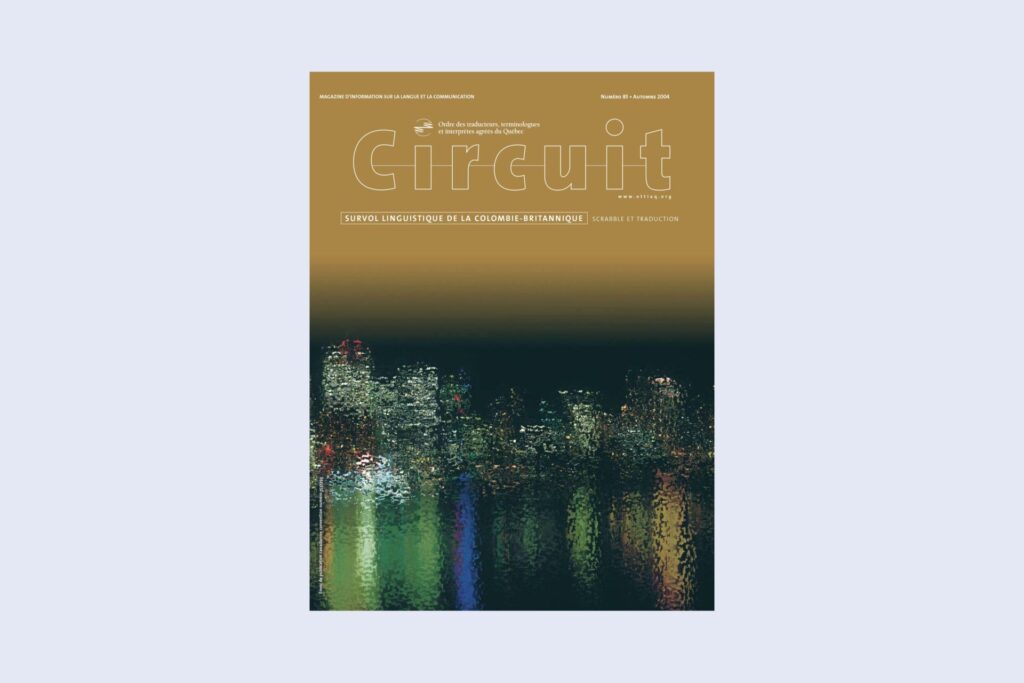L’avalanche de décrets, de mesures et de déclarations extraordinaires qui se répand de Washington depuis janvier dernier emporte avec elle un pan du vocabulaire administratif. Portrait à la sanguine d’une censure orwellienne.
Par Caroline Coicou Mangerel
Le 7 mars dernier, le New York Times publie une liste de termes, expressions et combinaisons de mots qui seront désormais bannis de l’usage administratif1. Cette liste, non exhaustive, concerne non seulement les ministères, mais aussi ce qu’on appelle les government agencies et d’autres organismes et institutions. Ainsi, les autorités ordonnent tout bonnement le retrait de certaines de ces expressions de sites Web gouvernementaux, mais aussi de programmes scolaires.
Le retrait de certains de ces termes correspond au désir d’élimination du concept même dont ils relèvent, comme tout ce qui a trait à la triade diversité, équité et inclusion, bête noire du parti Républicain depuis des années déjà : prejudice, unconscious bias, vulnerable populations, LGBTQ ou race and ethnicity sont à proscrire, mais aussi des termes aussi peu connotés que women, Black, gender et racism. Par ailleurs, l’interdiction d’autres expressions comme Gulf of Mexico se veut purement idéologique; elle porte toutefois la puissance d’un levier à exercer sur les « ennemis » désignés du gouvernement actuel, comme les médias traditionnels : l’Associated Press et ses journalistes ont ainsi été expulsés du pool de presse de la Maison-Blanche, précisément à cause de leur refus de remplacer le nom golfe du Mexique (Gulf of Mexico) par l’appellation Gulf of America2, préférée par Trump et entérinée notamment par Google. De plus, nous devons noter l’intention de renommer le golfe Persique (Persian Gulf) en Arabian Gulf, ou Gulf of Arabia, appellation également entérinée par Google Search. Traduire des textes pour les entreprises et entités états-uniennes présente dès maintenant quelques difficultés supplémentaires.
La littérature jeunesse mise à l’index
Ces mesures plus que choquantes suivent une tendance, déjà bien installée dans les régions conservatrices des États-Unis, qui consiste à interdire certains livres dans les bibliothèques scolaires ainsi qu’à défendre aux enseignants et enseignantes de les mettre au programme en classe. Élise Gravel, une autrice jeunesse bien connue des Québécois, en a subi les effets de plein fouet lorsque son album Pink, Blue and You!, publié en 2022 et traduit sous le titre Le rose, le bleu et toi! au Québec, a été mis à l’index dans les écoles de Floride, en compagnie de centaines d’autres publications traitant de l’identité de genre et de l’orientation sexuelle, d’ouvrages éducatifs sur la sexualité, mais aussi de livres abordant le racisme ou l’histoire de l’esclavage. Le prétexte officiel, dans tous ces cas, est de « lutter contre l’endoctrinement des enfants3 » ainsi que contre leur sexualisation précoce.
Le livre offre un simple point de vue concernant le respect du choix personnel des pronoms anglais « she », « he » et « they » et exemplifie une définition non traditionnelle – lire tradition des années 1950 – de la famille, comme une famille formée de deux parents du même sexe ou encore d’un grand-parent et de son petit-enfant. Ici, les concepts véhiculés par les appellations sont visés.
L’« annulation » de la science
Ce combat idéologique contre l’information menace de faire boule de neige. Car en dehors des actions symboliques, comme l’abolition du mois de l’Histoire des Noirs ou du Martin Luther King Day, le gouvernement actuel s’est attaqué au savoir à sa source même en décimant d’immenses morceaux des institutions fédérales et en congédiant les personnes qui détiennent l’expertise et les connaissances. Les structures scientifiques sont attaquées de plein fouet puisque, en plus d’expurger des termes essentiels des rapports et textes scientifiques, ce cataclysme vise le stockage de données et l’accès à l’information en liquidant d’immenses bases de données. Enfin, le muselage des universités s’ajoute à la vague de censure qui dévaste le pays : retrait des subventions, annulation de programmes de recherche, interdiction de cours et frappes policières dans les rangs étudiants, entre autres mesures; cela va jusqu’à la persécution de certains professeurs ou chercheurs et chercheuses, notamment ceux et celles qui viennent d’ailleurs et qui sont renvoyés dans leur pays d’origine sans procès, malgré les décisions contraires des tribunaux et de la Cour Suprême des États-Unis. Là encore, nous devons faire remarquer que le président états-unien désire abolir l’« habeas corpus » afin de pouvoir renvoyer toute personne sans autre forme de procès. Si cette volonté se concrétise, elle aura des répercussions sur les langagières et les langagiers exerçant aux États-Unis.
Ces mesures ne sont pas sans conséquence pour l’industrie langagière. Il faudra revoir la façon dont sont exprimés, par exemple, les concepts de « groundwater pollution » « housing affordability », « biologically male », « woman », « Black » et « socioeconomic ». Des heures de réflexion seront nécessaires. Par ailleurs, la traduction juridique est aussi touchée. Ainsi, comment traduire les concepts de « victim », « segregation », « Indigenous Community/Indigenous People » ou encore « oppression » sans mentionner ces termes? De plus, que dire de la disparition de certaines bibliothèques et bases de données gouvernementales, sans oublier l’impact de ces nouvelles circonstances sur les corpus qui nourrissent les outils d’intelligence artificielle. En effet, si ces corpus sont modifiés, le raisonnement qui soutient ces outils sera également changé.
Étant donné le pouvoir d’attraction considérable des États-Unis sur une grande partie de la planète, cette culture du bannissement qui bat son plein au sud de la frontière canadienne menace de s’infiltrer dans nos sociétés et nos modes de pensée. La vigilance dans tous les domaines de la traduction, de la terminologie et de l’interprétation s’impose. Il faut donc s’adapter aux nouvelles réalités, même temporaires, du marché, mais n’est-ce pas ce que font les langagières et les langagiers depuis toujours?
1 Karen Yourish, Annie Daniel, Saurabh Datar, Isaac White et Lazaro Gamio, « These Words Are Disappearing in the New Trump Administration », The New York Times, 7 mars 2025. https://www.nytimes.com/interactive/2025/03/07/us/trump-federal-agencies-websites-words-dei.html.
2 Agence France-Presse, « ‘Golfe de l’Amérique’ : la Maison-Blanche interdit encore l’accès à un journaliste », Radio-Canada Information, 12 février 2025, https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2140007/golfe-amerique-maison-blanche-interdit-acces-journaliste-associated-press.
3 Étienne Paré, « L’autrice Élise Gravel victime des conservateurs aux États-Unis », Le Devoir,
31 janvier 2023. https://www.ledevoir.com/lire/779974/l-autrice-elise-gravel-victime-des-conservateurs-aux-etats-unis.