Traduitdu et anglicismes
Le traduitu, c’est du français qui pense en anglais. Trop proche de l’original, il sonne faux et manque de sens. Dans ce texte, Carlos del Burgo, traducteur et terminologue agréé, passe en revue les erreurs de traduction les plus courantes et propose des façons simples de repérer les anglicismes.
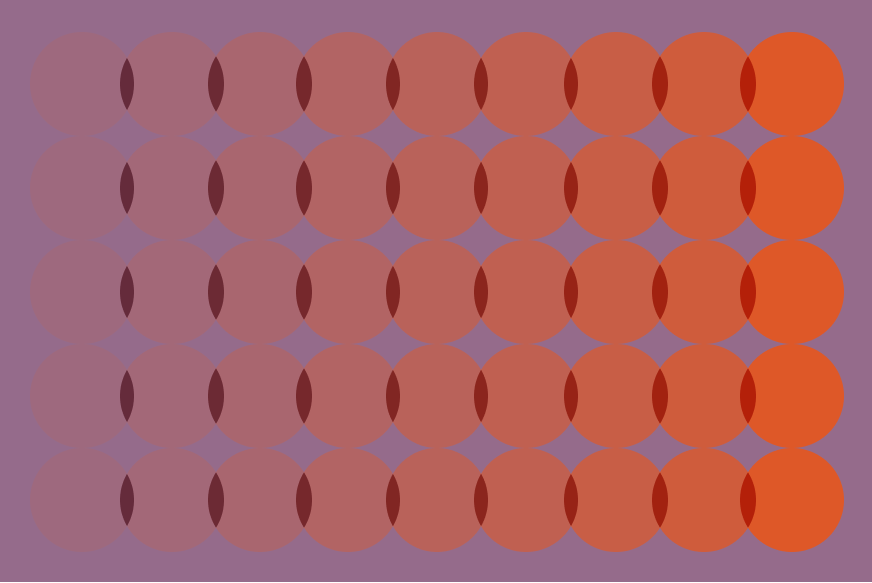
LE TRADUITDU
Le traduitdu résulte d’une traduction mimétique. C’est du réchauffé. Il est plus générique et moins caricatural que le franglais, le fragnol ou le spanglish.
L’astérisque précède une formulation fautive.
Voici donc quelques-uns des principaux facteurs qui concourent au traduitdu.
- La verbosité, au sens premier du terme. Il faut donc, à l’occasion, supprimer quelques verbes. Substantiver, nominaliser.
- I love to walk and to run. J’adore la marche et la course.
- La verbosité, au sens second. C’est-à-dire la redite, la répétition, la tautologie, la redondance et le pléonasme. On doit alors élaguer, fluidiser, redonner au texte un certain sens de la phrase. Recourir à l’entendement, utiliser des ellipses, faire bon usage des pronoms personnels. Éviter les longueurs inutiles.
- L’abus de verbes ternes, surtout le verbe dire.
- L’adverbomanie. Adverbe que pourra. L’adverbe français est nasal. Voire cacophonique, surtout quand il est servi en chapelets. La solution consiste souvent à adjectiver.
- To express one’s thoughts clearly, beautifully, convincingly. S’exprimer avec clarté, élégance et conviction.
- L’adjectif de relation, calqué de l’anglais.
- The postal employee. *L’employé postal.
- Devient : L’employé des Postes. Par contre, il existe des cas d’hypallages acceptables en français. Le cortège présidentiel. Tendre une main hésitante.
- The postal employee. *L’employé postal.
- La surcaractérisation issue d’une cascade de déterminants. C’est l’apport de précisions superflues. On cherchera alors à délester.
- The fish swam across the pond. Le poisson a traversé l’étang. (Inutile de préciser qu’il l’a traversé à la nage.)
- In London, England, it was really cold on this winter night. En cette soirée d’hiver, Londres était glaciale.
- L’omniprésence des unités de mesure anglo-saxonnes. Y aller d’unités SI, en alternance ou en exclusivité. Veiller à leur emploi judicieux. Convertir en arrondissant si la situation le permet. Se méfier de décade et décennie. Distinguer entre distances verticales et distances horizontales.
- I live in a suburb some 10 miles from Calgary, where I have dozens of friends. J’habite une banlieue à 15 kilomètres de Calgary, où j’ai des dizaines d’amis.
- On dira toutefois une douzaine d’œufs, de gâteaux, de bouteilles, etc.
- I met them two decades ago. Je les ai connus il y a vingt ans (il y a une vingtaine d’années).
- The Sixties were a great decade. J’ai adoré les années 60.
- Two decades ago, kids had longer hair. La génération précédente aimait les cheveux longs.
- Le Bismarck repose par 4 800 m de fond à quelque 1 100 km de Brest.
- I live in a suburb some 10 miles from Calgary, where I have dozens of friends. J’habite une banlieue à 15 kilomètres de Calgary, où j’ai des dizaines d’amis.
- La chiffromanie, usage systématique des chiffres arabes. Eux qui pourraient être remplacés, dans certains cas, par des chiffres romains ou par l’écriture en toutes lettres. Préférer XXe siècle à 20e siècle, même si les deux graphies circulent. Par ailleurs, chacun d’entre nous utilise un seuil, éminemment subjectif, marquant la transposition des lettres en chiffres. Pour certains, il s’agit de 17, pour d’autres, de 19, ailleurs encore, de 21… Solution : Mettre l’accent sur la logique interne du texte; lorsque les nombres ont valeur technique, quelle que soit leur ampleur, les exprimer en chiffres arabes (ou romains); sinon, en pleines lettres.
- Il y a six jours, la VeDivision blindée dressait le bilan suivant : 2 blessés, 3 tués, 5 prisonniers, 12 disparus.
- Par contre, en tête de phrase, on gardera toujours l’écriture en toutes lettres. Deux blessés et 3 tués seulement, un miracle!
- Il y a six jours, la VeDivision blindée dressait le bilan suivant : 2 blessés, 3 tués, 5 prisonniers, 12 disparus.
- La confusion entre la règle n et la règle n-1. Le billion n’est parfois qu’un tout petit milliard… Les scientifiques recourent aux exposants pour exprimer ces grandes valeurs mathématiques. Les chiffres ne trompent pas…
- The world’s population is 8 billion people. La population de la Terre est de 8 milliards d’âmes.
- La possessivite. Celle-ci appelle une solution plutôt simple : le recours à l’article défini.
- He put his hat on his head. Il a mis son chapeau sur la tête. Ou : Il mit son chapeau.
- Le tic du déictique. On doit, pour y remédier, faire du délestage ou recourir à un article indéfini.
- I saw this great movie. J’ai vu un film fantastique.
- La majusculite aiguë. Il serait casse-cou d’abuser du haut de casse.
- A Computer Technology Dictionary. Un dictionnaire d’informatique.
- Par contre, quand il s’agit du titre de l’ouvrage, ce sera le Dictionnaire d’informatique.
- A Computer Technology Dictionary. Un dictionnaire d’informatique.
- Le tandem zeugme et anacoluthe.
- *Monter et descendre du bus. (zeugme ou zeugma)
- Devient : Monter dans le bus puis en redescendre.
- *Dans l’attente de vos nouvelles, veuillez agréer, Messieurs, nos salutations distinguées. (anacoluthe; ce mot est d’ailleurs un des jurons préférés du capitaine Haddock)
- Devient : Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions d’agréer, Messieurs, nos salutations distinguées.
- *Monter et descendre du bus. (zeugme ou zeugma)
- L’effacement de certains idiomatismes pronominaux.
- Wash your hands and comb your hair. *Lavez vos mains et peignez vos cheveux.
- Devient : Lavez-vous les mains et peignez-vous les cheveux (coiffez-vous).
- Wash your hands and comb your hair. *Lavez vos mains et peignez vos cheveux.
- La typographie mimétique. Il convient d’utiliser les protocoles de typographie propres à la langue d’arrivée. Songer donc à substituer des guillemets chevrons (« ») aux guillemets anglais ( » « ). Remplacer les apostrophes droites (dites dactylographiques) par des apostrophes courbes (dites typographiques ou traditionnelles). Ménager des espaces insécables lorsqu’ils sont de mise.
- Le et causal (dit fausse coordination). En français, la conjonction de coordination et constitue un synonyme du mot plus. Elle n’a pas valeur causale. Elle cédera sa place à des formulations plus précises.
- Divide and conquer. Diviser pour régner.
- Le mot avec, pris dans un sens large, à l’anglaise.
- *Avec ces intempéries, le concert sera annulé.
- Devient : À cause de, Compte tenu de ces intempéries, le concert sera annulé.
- *Avec ces intempéries, le concert sera annulé.
- La gaucherie de certaines formes de féminisation. Le français est une langue genrée. Pour être inclusif, il faut parfois songer à employer des épicènes, des collectifs et d’autres adaptations quand cela évite des pirouettes typographiques ou lexicales (comme l’étrange pronom personnel iel).
- *Les étudiants et les étudiantes, *Les étudiant(e)s, *Les étudiant.e.s
- Devient : La classe (ou, au besoin : Le corps étudiant)
- *Les voyageurs et voyageuses
- Devient : les touristes
- *Les salariés et salariées
- Devient : Le personnel (ou : Les membres du personnel)
- *Les étudiants et les étudiantes, *Les étudiant(e)s, *Les étudiant.e.s
- La carence de procédés rhétoriques. Quand on traduit de l’anglais, on oublie de recourir à la négativation ou à la fausse interrogation (fausse question). C’est malheureux, car ce sont là deux procédés dont la valeur rhétorique est bien connue et qui, à la clé, produisent une formulation des plus idiomatiques.
- I agree. Je ne dirais pas non.
- Let’s do it. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi pas?
- Hold the line. Ne quittez pas.
- La confusion des rapports logiques. On doit viser le terme juste, ce qui présuppose une compréhension rigoureuse du texte; de la sorte, on tiendra compte des écarts de sens et de certaines asymétries dans le découpage de la réalité.
- La structure ordinale à l’anglaise. Faire preuve de logique. En effet, comment pourrait-on être à la fois troisième et plus grand?
- Germany is our third largest partner. L’Allemagne constitue notre troisième partenaire commercial (on pourrait rajouter en importance).
- Les anglicismes, appel des sirènes. Règle générale, on évitera les deux extrêmes, c’est-à-dire l’hypercorrection (purisme) tout comme l’effet de mode (laxisme). On se méfiera des faux-amis, ainsi que des usages en transition et anglicismes de fréquence. Consulter la source ci-dessous pour une présentation détaillée de quatorze catégories d’anglicismes.
- La passivite. Il serait judicieux de changer de voie. On a l’embarras du choix : l’actif, l’infinitif, l’impératif, le nominal, le pronominal, l’indéfini. Et, s’il le faut, le pronom on, qu’on qualifie à tort de « pronom imbécile ». Certes, à petites doses, le passif demeure pratique, surtout dans le domaine technique ou scientifique, là où l’identité précise de l’agent humain ou mécanique n’importe guère.
- Key should be turned clockwise. Vous tournerez la clé vers la droite, tourner la clé…, tournez la clé…, rotation de la clé…, la clé se tourne…, il faut tourner la clé…, on doit tourner la clé…
- L’omission des charnières ou bien leur mauvais ancrage dans la phrase. Songer à rétablir un certain nombre de charnières puis à les ramener, de temps en temps, en tête de phrase. Il en va de même des circonstancielles.
- We cannot operate without food. L’estomac vide (ou À jeun), on ne peut vraiment fonctionner. (Déplacement facultatif)
- L’abus de l’animisme. L’animisme existe en français, mais il reste plus courant en anglais. Il prendra, dans bien des cas, une allure un peu familière.
- *Le document parle de traduction.
- Devient : Le document traite de traduction, porte sur la traduction.
- *Le document parle de traduction.
- Le tutoiement intempestif, dans des textes administratifs, techniques ou scientifiques. Opter pour le vous ou pour d’autres formulations, comme le on ou la forme impersonnelle.
- L’omission des titres de civilité (M., Mme, Dr, Me, etc.).
- Smith disagreed. (ou Mme) Smith a exprimé son désaccord.
- Par contre, Trudeau déclarait que… Churchill affirmait que… McCartney joue sur une basse Hofner.
- Smith disagreed. (ou Mme) Smith a exprimé son désaccord.
- L’emploi familier du prénom. Remplacer là aussi par le nom de famille, précédé du titre de civilité.
- John stated that… M. Smith a déclaré que…
- Par contre, on dira que C’est bien John qui a écrit cette ballade. Il s’agit des Beatles, après tout!
- Le comparatif elliptique (alias faux comparatif). Plusieurs choix idiomatiques s’offrent ici.
- Greater Montreal. Le Grand Montréal, le Montréal métropolitain, l’agglomération montréalaise, la conurbation montréalaise.
- John stated that… M. Smith a déclaré que…
LA FRANGLOPHONIE SOUS TOUTES SES COUTURES
Une des façons d’endiguer la déferlante des anglicismes consiste à en recenser toutes les variétés – et elles sont nombreuses. Il y en a pour tous les goûts. Apprenons donc à en connaître les modalités avant même de chercher à corriger l’erreur.
1. Anglicismes lexicaux
L’anglicisme lexical montre qu’on peut donner un autre sens à l’expression les deux solitudes : l’anglicisation telle qu’elle se pratique au Québec et au Canada, d’une part ; et celle dont sont friands nos cousins outre-Atlantique, les Hexagonaux – nos ancêtres les Gaulois, oui, mais aussi, les Belges, les Suisses et les francophones des quatre coins du monde.
Ce type d’anglicisme permet le voyagement et l’exotisation à peu de frais. Pas besoin d’emprunter le tunnel sous la Manche ou de prendre l’avion pour l’Amérique. Suffit de parsemer un texte de quelques mots anglais, et voilà, on affiche son bilinguisme.
Au Québec, par contre, sauf pour un certain nombre de classiques devenus indéboulonnables (bumper, muffler et compagnie), on a tendance à réagir fortement devant l’anglicisme lexical, qui est un emprunt intégral. Nous habitons la seule partie du monde où le panneau Stop est traduit par Arrêt, même si Stop est un mot allemand avant que d’être anglais, et que Arrêt signifie surtout Station (ex. : arrêt d’autobus).
Nous vivons dans une partie du monde où USA est souvent remplacé par l’énigmatique et imprononçable É-U, tandis que week-end cède joliment la place à fin de semaine.
L’exotisme n’a pas prise. Et n’a pas pris. Pour cause (du verbe causer = parler) : nous sommes en plein continent anglo-saxon. Or, il n’y a pas exotisme sans distance et sans distanciation précédant le rapprochement. Cette distance n’existe pas dans le Nouveau-Monde.
On a donc naturellement créé des mots français, notamment en informatique : matériel, logiciel, courriel, pourriel, etc., dont certains ont franchi l’Atlantique, et d’autres pas. On a contribué à la francisation de divers sports pourtant très populaires en Europe, comme le football (soccer). Nous disons donc coup de pied de coin puis but là où les Européens disent souvent corner et goal ; nous parlons du gardien, voire du cerbère plutôt que du goalkeeper. De quoi y perdre son latin. Et, à ce propos…
2. Anglicismes latins (latino-anglicismes)
À chacun ses latinismes et latino-anglicismes. Le français et l’anglais modernes ne recourent pas forcément aux mêmes classiques.
Raison pour laquelle l’anglais reprend e.g. et i.e là où le français les traduit par p. ex. et c.-à-d.
Dans la Belle Province, le latinisme fax (issu de facsimile) donne lieu au triolet télécopie / télécopier / télécopieur.
3. Anglicismes affixés (hybrides)
Ces affixations se produisent quand on allonge ce qui constitue déjà un anglicisme lexical, pour lui ajouter de nouvelles formes (nominales, verbales, adverbiales, adjectivales, etc.). Ex. : L’emprunt blast donnera le verbe blaster. Le mot custom produira customiser. Transition parfois envahissante : songer à custom, customiser, customisable, customisateur, customisatrice, customisation… là où le verbe personnaliser et ses dérivés existent pourtant.
4. Anglicismes phonétiques
L’anglicisme phonétique est une déformation de la prononciation, rendue plus « anglaise ».
Ex. : le mot chèque émis sur le modèle de Tchèque ; l’alcool consommé comme s’il contenait un h
(alko-ol), et le pyjama arboré comme s’il s’écrivait avec un d (pydjama).
5. Anglicismes graphiques ou orthographiques
Ce type d’anglicisme vient tout simplement modifier le libellé du mot français, désormais vêtu à l’anglaise. On relève donc des addresse et apartement, au lieu de adresse et appartement (sous l’influence des mots anglais address et apartment).
6. Anglicismes typographiques
Ici, un certain nombre d’artifices de typographie s’estompent sous l’influence de l’anglais. Raison d’être des no, nbre, qté, H2O ; ainsi que du guillemetage à l’anglaise (‘’).
Normalement, on écrit pourtant no, nbre, qté, H2O ; et l’on use du guillemetage français (« »). Sans compter les règles de ponctuation, qui ne sont pas les mêmes dans les deux langues.
7. Anglicismes de fréquence
Dans cette catégorie, l’usage du terme n’est pas, en soi, erroné ; ce qui l’est c’est son taux d’incidence. Autrement dit, si l’on n’était pas bilingue, on n’aurait que rarement recouru au terme en question.
Dans la langue de Shakespeare, les mots company et employee sont monnaie courante, alors que dans celle de Molière, dans un français non traductif, on parle de l’entreprise et de ses salariés (ou de son personnel), plutôt que de la compagnie et de ses employés.
On rappelle que le mot salariés inclut les employés (dans les bureaux) et les ouvriers (dans les usines) ; c’est donc un générique. Même chose pour le mot anglais employee (tous les gens qui travaillent pour l’entreprise sont des employees)…
Conclusion : tout employé est un employee, mais l’inverse n’est pas vrai.
Autre situation du genre : le mot decade est bien plus fréquent en anglais que son équivalent décennie, qui figure pourtant au dictionnaire ; on dira au cours des trente dernières années, plutôt qu’au cours des trois dernières décennies ; la phrase Some wars last a decade se rendra naturellement par Certaines guerres durent dix ans (variante : Certaines guerres durent une dizaine d’années).
L’usage est fou, mais l’usage est roi.
8. Anglicismes bidons ou anglicismes fantômes
L’anglomanie peut amener à créer des mots anglais… qui n’en sont pas.
Ainsi, à Paris comme à Lyon, on peut aller au pressing (chez le teinturier), ce qui permet faire de faire un peu de footing (marche) dans le parking (stationnement). Autant de vocables absents des dictionnaires anglais.
9. Anglicismes de maintien
Ici, on est à contre-pied du cas précédent. Le terme anglais existe bel et bien ; c’est sa traduction littérale qui fonctionne de moins en moins. Il s’agit donc d’une survivance d’un vieil usage français, au Canada et dans certaines régions de France. On dira alors, un peu vite, accommoder quelqu’un pour loger quelqu’un.
Dans un même ordre d’idées, un Européen peut marier sa fille sans qu’on crie à l’inceste, puisqu’il la marie à quelqu’un ou à quelqu’une d’autre. Au Québec, par contre, marier quelqu’un conserve souvent son sens ancien de épouser quelqu’un.
10. Anglicismes sémantiques
Les anglicismes sémantiques découlent d’une modification du sens français imputable à l’influence d’un faux-ami anglais. Cela explique le calque abusif de pamphlet au sens de dépliant ou brochure. Un peu comme l’usage de raisin au sens de raisin sec ; la confusion entre prune et pruneau ; entre librairie et bibliothèque. Dans chacun de ces cas, on a gauchi le sens figurant dans les dictionnaires.
11. Anglicismes morphologiques
Dans cette catégorie, on trafique les morphèmes de manière à recréer à l’identique l’image du terme anglais. On pourrait se demander pourquoi l’anglais use du pluriel pour les mots customs, physics, linguistics, avionics, statistics… là où le français emploie le singulier pour douane, physique, linguistique, avionique, statistique.
C’est ce qu’on appelle l’usage.
Cela étant, on dit plus couramment les mathématiques que la mathématique aujourd’hui…
On note que la démarche morphologique produit parfois des barbarismes, comme complétion au sens d’achèvement ou de parachèvement.
On observe aussi la fausse construction direct du fabricant (qui signifie, en réalité, directement du fabricant).
12. Anglicismes syntaxiques, ou anglicismes de structure
Un franglophone dira qu’il siège sur un comité (alors qu’il siège à un comité) ; qu’il téléphone quelqu’un (alors qu’il téléphone à quelqu’un). Les mots clés (siéger + comité) vont très bien ensemble ; ce qui ne convient pas c’est le mot de liaison (ou son absence) dans l’expression.
Il arrive aussi qu’on fasse usage de certains passifs abusifs (brochures à être distribuées) là où il suffirait d’un infinitif (brochures à distribuer).
13. Anglicismes phraséologiques
On se trouve devant un emprunt de locution ou d’image. Ici, ce n’est pas le mot de liaison qui fait défaut. Cette fois, c’est un des mots clés qui est mal choisi. Ex. : demander une question, faire du sens ; on dira plutôt poser une question, demander quelque chose ; c’est ça avoir du sens.
14. Anglicismes gestuels
C’est la forme la plus rare des anglicismes, qu’on pourrait qualifier de cinétiques ! Ce sont les guillemets anglais dessinés dans les airs par crochetage de l’index et du majeur des deux mains, quand ces doigts se dressent et s’abaissent, comme par analogie de forme. C’est aussi le cas du L de LOSER formé par le geste qui représente le chiffre deux (pouce et index droits écartés) placé au-dessus de la tête de l’orateur. Vu d’en face, ça donne un L majuscule…
Avec l’espoir que ce portrait Anglicismes vous aura plu.
On dit souvent que, à force d’être pressé et de mettre les deux langues sur le même pied, on finit par mettre les deux pieds sur la même langue…
Chronique de Carlos del Burgo, terminologue agréé et traducteur agréé
