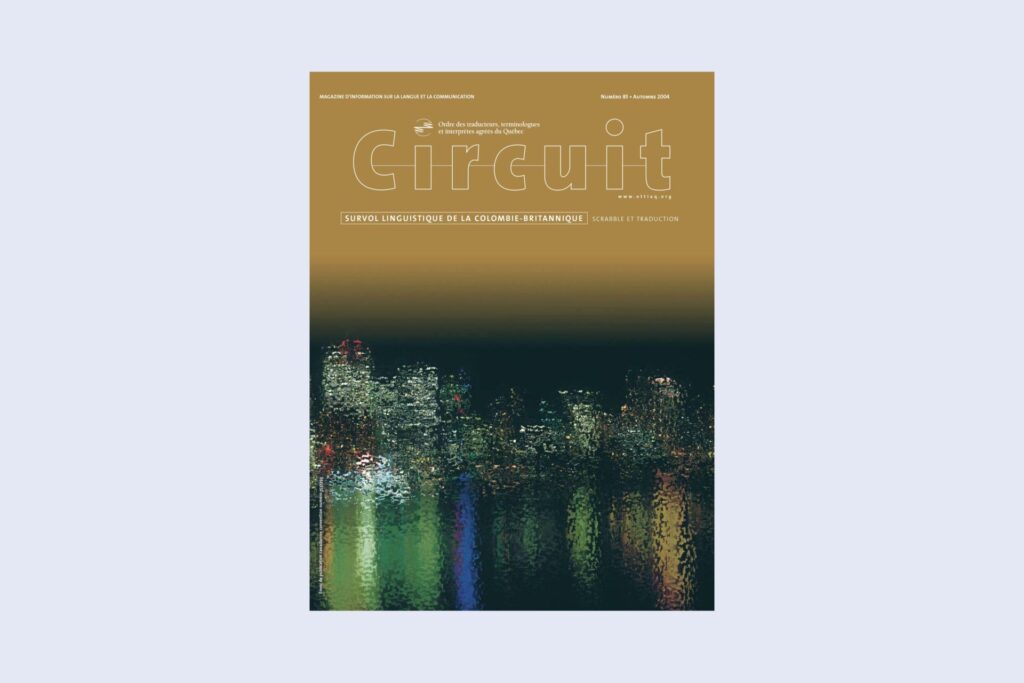Langue officielle, traduction et politique aux États-Unis à l’ère de Donald Trump

Par Marc Pomerleau, traducteur agréé
De 17761 jusqu’à mars 2025, il n’y avait pas de langue officielle aux États-Unis. Pourquoi n’y en avait-il pas et pourquoi y en a-t-il une aujourd’hui? La réponse courte, c’est qu’il n’y a rien à ce sujet dans la Constitution américaine et que le pays n’a jamais légiféré en ce sens. Toutefois, depuis le 1er mars 2025, en vertu d’un décret du président Donald Trump, l’anglais a été désigné comme langue officielle des États-Unis2.
La réponse longue, c’est que depuis la fondation du pays, l’anglais est la langue la plus répandue dans le pays, celle qui occupe la totalité (ou presque) de l’espace public et des médias, celle dans laquelle le gouvernement fonctionne, celle de la réussite économique et de la mobilité sociale. L’anglais est également la langue que les immigrants apprennent, qu’ils y soient contraints ou non, et qui devient la langue la mieux maitrisée, puis maternelle, des générations suivantes. Dans les faits, près de 80 % de la population du pays parle anglais à la maison et un autre 15 % maitrise cette langue; bref, 95 % de la population états-unienne parle anglais3. Qu’une petite partie de la population ne maitrise pas la langue officielle, qu’elle le soit de jure ou de facto, est tout à fait normal, et c’est une réalité dans tous les pays, notamment en raison des mouvements de population.
Compte tenu de ce contexte de prédominance quasi absolue de l’anglais dans toutes les sphères de la société américaine, le besoin d’en faire la langue officielle ne s’était jusqu’ici jamais fait sentir. Il y a certes eu des initiatives en faveur d’une telle mesure, mais elles ont toutes été abandonnées ou déboutées en justice au nom des libertés individuelles. Il se pourrait bien, dans cet esprit, que l’officialisation de l’anglais aujourd’hui en vigueur soit contestée puis invalidée en cour ou que le décret promulgué par Donald Trump soit révoqué par son successeur. On pourrait invoquer, par exemple, la Constitution et le Civil Rights Act de 1964 qui interdit toute forme de discrimination, notamment celle fondée sur l’origine nationale, ce qui inclut la langue4.
Et la traduction dans tout ça?
Les États-Unis ont une grande tradition de traduction à des fins civiques. Le gouvernement fédéral, les États, les institutions et les organismes publics en général, de même que plusieurs organismes communautaires, ont l’habitude de fournir des services dans plusieurs langues, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de la traduction et de l’interprétation. On pourrait croire qu’il s’agit d’une pratique relativement récente et qui concerne principalement l’espagnol, mais rien n’est plus faux. Dès la fondation du pays, on a traduit certains des documents les plus importants pour les citoyens et citoyennes, dont la Déclaration d’indépendance, la Constitution et l’hymne national, et ce, dans certaines des langues les plus parlées sur le territoire, dont l’allemand, le néerlandais, le français et l’espagnol.
L’offre de services dans les principales langues de l’immigration (récente ou non) fait donc partie de l’ADN de la nation; cela facilite l’intégration et la participation citoyenne. Ces mesures, bien qu’elles existent depuis 250 ans, ne sont que transitoires; en effet, les immigrants apprennent l’anglais et leurs enfants s’assimilent, la langue maternelle disparaissant généralement au bout de deux ou trois générations. En ce sens, la traduction et l’interprétation ne sont pas des droits en soi, mais des services nécessaires, voire des accommodements qui permettent d’exercer d’autres droits, comme le droit de voter et le droit d’accéder à la justice et aux services sociaux5. C’est pour cette raison que le site vote.gov du gouvernement américain fournit des renseignements sur la méthode à suivre pour s’inscrire comme électeur/électrice et exercer son droit de vote dans plus de quinze langues, choisies en fonction des données recueillies lors du recensement6. Il a d’ailleurs été démontré que la traduction de matériel électoral fait augmenter le taux de participation aux élections7. C’est également pour cette raison que les services d’interprétation médicale et juridique sont si développés aux États-Unis. Le décret de Donald Trump ne change pas cette offre; il précise même que les agences n’ont pas à cesser d’offrir des produits et services dans des langues autres que l’anglais8. Bref, que l’anglais soit ou non la langue officielle des États-Unis ne change pas grand-chose sur le terrain, à part le fait de plaire à une certaine base conservatrice.
Références
Córdoba Serrano, María Sierra et Diaz Fouces, Oscar. 2018. Building a field: Translation policies and minority languages. International Journal of the Sociology of Language, n° 251, p. 1-17.
Córdoba Serrano, María Sierra. 2016. Translation Policies and Community Translation: the U.S., a case study. New Voices in Translation Studies, no 14, p. 122-163.
Healy, Jack. 2025. Trump Made English the Official Language. What Does It Mean for the Country? The New York Times, 3 mars.
Leclerc, Jacques. 2025. États-Unis d’Amérique. L’aménagement linguistique dans le monde. Québec, CEFAN, Université Laval.
Lozano, Rosina. 2019. Vote Aquí. Modern American History. n° 2, p. 393-396.
Olson, Daniel J. 2025. Making English the official US language can’t erase the fact that the US has millions of Spanish speakers and a long multilingual history. The Conversation, 1er mars.
Marc Pomerleau est associé de recherche en traduction à l’Université McGill. Ses recherches portent sur les politiques linguistiques et de traduction, le multilinguisme et les langues minoritaires.
1Année de la Déclaration d’indépendance des États-Unis.
2 The White House. 2025. Presidential Actions: Designating English as the Official Language of The United States, https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/03/designating-english-as-the-official-language-of-the-united-states/
3Bureau du recensement des États-Unis, https://data.census.gov/table?q=B16004&y=2023
4 USA. 2000/2023. Federal Protections Against National Origin Discrimination. U.S. Department of Justice, Civil Rights Division, https://www.justice.gov/crt/federal-protections-against-national-origin-discrimination-1
5 Voir Córdoba Serrano, María Sierra et Diaz Fouces, Oscar. 2018. Building a field: Translation policies and minority languages. International Journal of the Sociology of Language, n° 251, p. 1-17.
6 USAGov. 2024. Why vote.gov supports multiple languages. United States government, https://blog.usa.gov/why-vote.gov-supports-multiple-languages
7 Voir Hopkins, Daniel J. 2011. Translating into Votes: The Electoral Impacts of Spanish-Language Ballots. American Journal of Political Science, vol. 55, no 4, p. 813-830.
8 “Agency heads are not required to amend, remove, or otherwise stop production of documents, products, or other services prepared or offered in languages other than English”.